Un flingue pour se faire entendre, un stylo pour se faire comprendre. Voilà ce que le film expose, le parcours identitaire de quatre jeunes antillais, arrivés en métropole dans les années 70. Ce film est librement inspiré du livre autobiographique «Le Gang des Antillais» de Loic Lery. Un authentique « thriller nègre », un film de genre dans la veine du cinéma afro-américain, avec des héros contemporains, par le réalisateur de Neg Maron, Jean-Claude Barny.
Contrôle d’identité, s’il vous plaît ?
Jean-Claude Barny, j’ai 50 ans, je suis d’origine afro antillaise. Mes origines sont diverses mais je dirais essentiellement guadeloupéennes et mes grands-parents viennent de Trinidad et Tobago. C’est ce qui me permet de ne pas me sentir totalement rattaché à la France et me sentir libre d’une certaine manière. Je suis un réalisateur avec deux longs métrages à mon actif, une série, un téléfilm et un passé dans les clips vidéos et les courts métrages.
Le cinéma, un rêve depuis gosse ?
Comme beaucoup de passionnés, entre 12 et 13 ans, j’ai eu une consommation excessive de l’image, une véritable addiction. Avec mes potes de la cité où j’ai grandi, nous allions très régulièrement au cinéma. Cela me paraissait tellement naturel. Et quand j’ai eu la possibilité à un moment donné de faire un choix, je me suis rapproché de gens qui étaient dans cette mouvance cinématographique. À 20 ans, j’ai rejoint une bande de copains où il y avait Matthieu Kassovic, Vincent Cassel, Léa Drucker, etc. On avait entre 20 et 23 ans et on avait soif d’être réalisateurs et/ou acteurs. Nous étions une génération un peu bruyante qui faisait d’ailleurs écho à l’éclosion du mouvement hip-hop dans la musique. J’ai choisi de rejoindre Mathieu (Kassovic) sur ses courts métrages, puis sur son 1er long métrage : La Haine. J’ai eu carte blanche pour faire le casting. Il avait choisi les 3 principaux acteurs : Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui et Vincent Cassel et je m’étais chargé du reste, en partant à la pêche aux personnages avec de « vraies gueules ». C’est là que je me suis rendu compte qu’il y avait encore beaucoup de choses à faire dans ce métier avec les gens issus des minorités. J’ai compris également que si je voulais exprimer pleinement ma sensibilité, il fallait que je passe par la réalisation.
Au mois de novembre sort Le Gang des Antillais. Revenons sur le cheminement de ce film que vous portez depuis un long moment. Pourquoi une telle attente ?
Principalement, comme pour beaucoup de films, les difficultés sont financières. Aujourd’hui, faire un film qui dépasse les clichés de la comédie grand public est très difficile à financer. Pas seulement les films afro, mais le cinéma d’auteur dans son ensemble. Nous avons la particularité d’être dans une niche donc nous prenons deux fois plus de temps que la normale. Nous sommes noirs et nous ne sommes pas très présents dans les médias donc il n’y a pas de curseur, d’ascenseur pour nous mettre en lumière. Sauf si tu fais un film comique ou alors un film dans lequel on sent que tu ne mets pas en danger l’esprit général que proposent les médias. Si tu commences à être originaire « de » et que tu tiens des propos un peu virulents ou conscients, ce n’est pas possible. Dans les années 70, il y avait un cinéma de revendication. Aujourd’hui, dans les années 2000, cela n’existe plus. Mon film a donc mis du temps, quasiment 6 ans, à cause du montage financier et des réticences quant au casting.
Parlez-nous de votre casting justement…
L’idée initiale était d’ouvrir le casting à des acteurs de talent, d’origines diverses. Le film s’appelle Le Gang des Antillais mais l’idée n’était pas d’enfermer la distribution des rôles uniquement à des gens de la communauté antillaise. Eriq Ebouaney et Adama Niane sont d’origine africaine, Djédjé Apali et Vincent Vermignon mes premiers rôles sont d’origine antillaise ou encore mes amis Romane Bohringer et Mathieu Kassovitz. L’idée était d’avoir un film qui revendique le droit à une sorte de pack de talents. Par exemple, Djédjé Apali qui est quelqu’un qui s’est révélé lors du casting. À la base, Il était venu pour un rôle précis – certes majeur – et il fut tellement époustouflant, que l’évidence s’est faite qu’il devait avoir le premier rôle de Jimmy Larivière. Une des choses frappantes dans ce film est la B.O explosive avec un mélange de hip-hop, soul, vibes caribéennes… C’est une idée de mon producteur et du compositeur James BKS qui ont trouvé qu’il était intéressant de proposer à des artistes engagés un regard sur le film. Je ne voulais que des artistes qui avaient une certaine conscience de leur métier et avec une véritable plume. Tous ceux qui font partie de cette B.O sont avant tout des gens qui savent écrire cette poésie urbaine, avec une certaine rage et déchirure. Aujourd’hui, nous sommes tombés dans le rap game où ce sont les rimes qui font plus la place à l’écriture. Je trouve, avec fierté, que cette B.O n’est pas un simple goody, mais le véritable bras musical de ce film !
Quel est le message véhiculé derrière ce film ?
Bien que l’action se passe dans les années 70, on n’a de cesse de me répéter que les problématiques évoquées sont très actuelles. Les politiques ont joué à des jeux très dangereux et nous ont poussé dans le fossé à vouloir trouver, comme à chaque époque, un mouton noir, une communauté à discréditer, un palliatif aux problèmes. Je suis très touché de voir aujourd’hui à quel point on maltraite la communauté maghrébine, comme la communauté afro le fut en son temps. C’est un film de conviction et d’engagement qui répond à une lutte sociale, raciale et qui pose la question : Que faire des gens que l’on a fait émigrer ? La fracture est réelle.
Quel état des lieux faites-vous du cinéma noir en France ?
Un désastre. Culturellement parlant, si on observe l’ensemble des pays du monde, les plus grands talents ont toujours émergé de la banlieue ou des minorités. Par essence même, le talent émerge souvent de la difficulté d’exister et, en termes de difficultés, nous étions bien servis en France ! Sauf qu’en France, il y a des personnes qu’on a volontairement bloqué. Sans entrer dans une parano, c’est quelque chose qui a été mis insidieusement en place pour qu’il n’y ait zéro exemple de réussite noire qui puisse influencer l’inconscient collectif français. Les seuls qui sont les bienvenus à la table sont ceux qui se rangent dans une catégorie un peu « clownesque », d’où les nombreux humoristes noirs qui ont émergé. Pour le reste ? Zéro.
La responsabilité n’incombe-t-elle pas également à vos confrères réalisateurs ?
Je suis effectivement très déçu par notre profession. Ce sont des gens avec qui j’ai grandi, qui ont écouté la même musique que moi, acheté les même vinyles que moi… S’ils sont en mode survie et qu’ils veulent bouffer, je peux l’entendre, mais pour les réalisateurs qui sont déjà assis et qui ont déjà amassé de beaux succès, n’ont-ils pas envie de montrer qu’un acteur noir français, non issu de la scène humoristique, peut aussi occuper une tête d’affiche, peut tenir la réplique à une actrice blanche sans que cela ne fasse l’objet de tous les clichés ? Pourquoi ne doit-on laisser la part belle qu’à des comédies dénigrantes ?
Portrait chinois : si vous étiez un film ?
12 hommes en colère, le plus beau film sur l’injustice.
Portrait chinois : si vous étiez un acteur ?
Richard Pryor, il était intellectuellement tellement brillant !
Si je vous dis le mot “Roots”, vous me répondez ?
Ma mère.
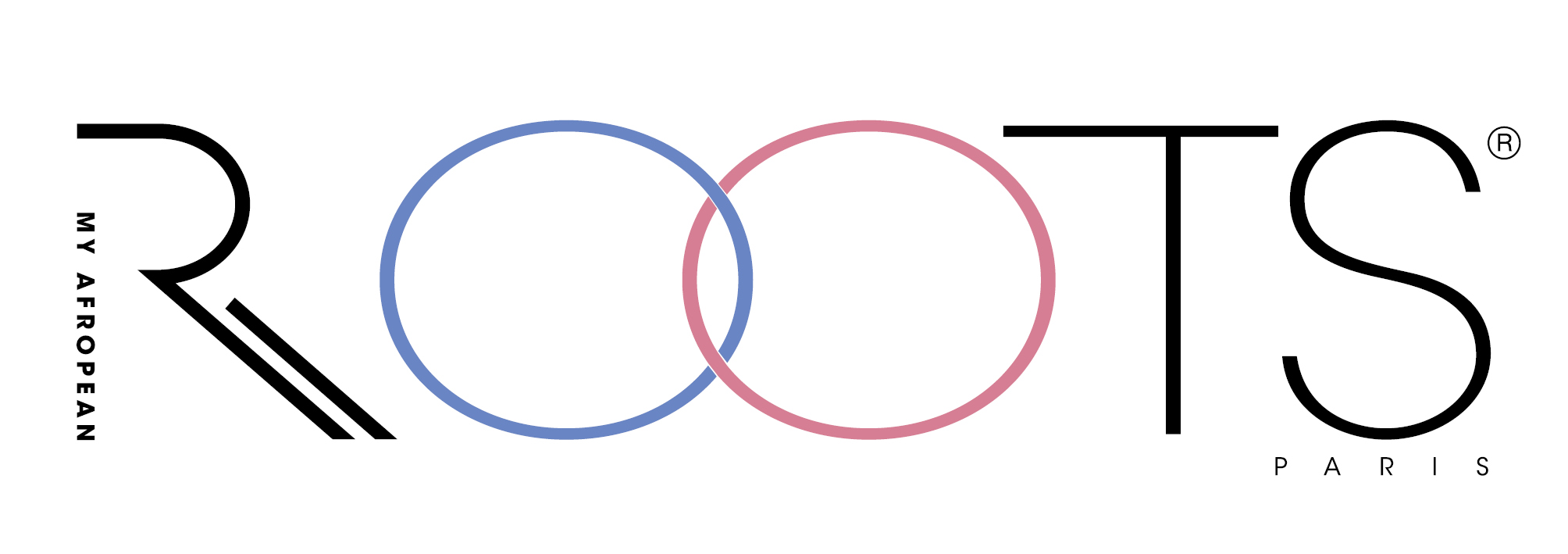




















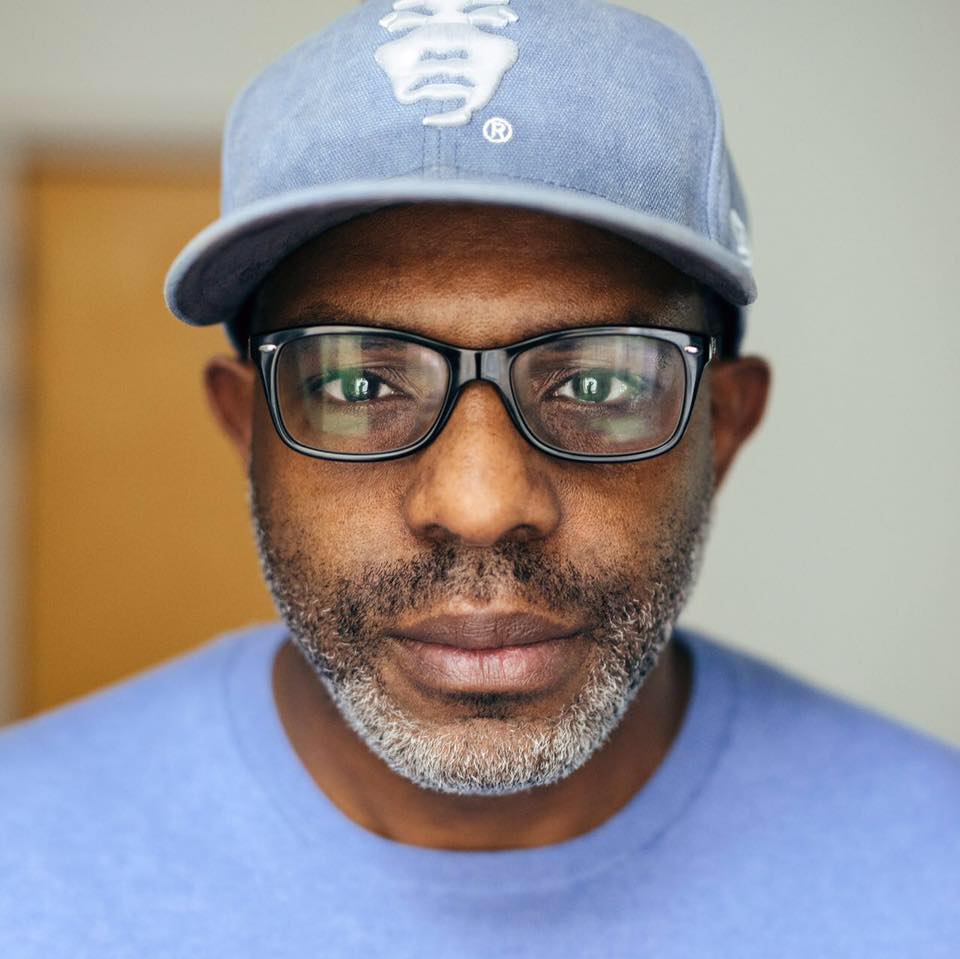



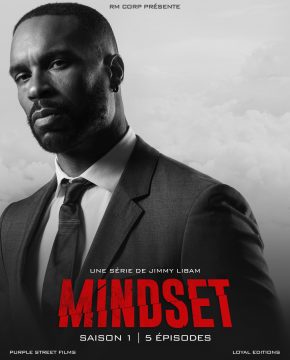






Commentaires