« Je peux affirmer que je suis celui qui a créé l’afro love. Je n’ai juste pas mis un nom ou une empreinte sur ce que je venais de créer mais les faits sont là. On l’a fait avant Aya, avant Dadju, avant TayC. »
Contrôle d’identité, s’il vous plaît ?
Elinga Onana, plus connu sous le nom de Stimo. Je suis né au Cameroun en 1991, à Yaoundé. J’ai baigné, dès tout petit, dans le monde de la culture. En Afrique, j’ai commencé par la danse afro en imitant les chorégraphies de Koffi Olomide, avant d’arriver en France, à l’âge de 9 ans, et d’embrasser toutes les disciplines de l’univers hip-hop: la musique, le deejaying, la danse, le graffiti… Aujourd’hui, beaucoup me considèrent comme un producteur, celui qui a révélé l’artiste Ya Lévis, mais je trouve cela trop réducteur. Je me décrirais plutôt comme un activiste de la culture hip-hop.
La plupart des passionnés qui abordent tous les univers du hip-hop se cantonnent, généralement, au statut d’artiste. Qu’est-ce qui vous a fait basculer dans un profil plus “business”, en devenant producteur ?
Je pense que j’ai toujours eu cette fibre du business. Déjà en Afrique, alors que j’étais un tout jeune garçon, je faisais du commerce en vendant des noix de cola, des œufs, j’arpentais les rues de Yaoundé en ramassant des bouteilles que je revendais pour m’acheter des paires de basket. Je ne viens pas d’une famille aisée mais j’étais scolarisé dans une école où il fallait être propre sur soi (rires). Ma mère ne pouvait pas me payer des paires à 100 ou 200 euros. J’ai donc choisi de me prendre en main et d’aider ma mère. Je vous parle d’une période où j’avais 7 ou 8 ans… Tout part de là. À mon arrivée en France, plus je grandis et plus je me rends compte que je suis bon dans la gestion de l’argent. Je comptais, je gardais, je planifiais. J’avais un rapport avec l’argent qui était particulier, je voulais comprendre comme les business fonctionnaient, comment épargner, comment investir… Je me rappelle que, plus jeune, j’étais toujours celui qui restait avec les « vieux ». J’aimais aller au village, parler avec mon grand-père, l’accompagner aux champs…
Et quand tu restes avec les vieux, tu entends des choses que d’autres enfants n’entendront jamais. En résumé, ma transition vers le business a été naturelle car j’avais cela en moi.
À quel moment avez-vous endossé le costume de producteur ?
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour ma première fois, en 2012, j’ai autoproduit mon album, qui est d’ailleurs disponible sur les plateformes. À ce moment-là, je travaillais à l’aéroport Charles de Gaulle et, en parallèle, je dansais, je donnais des cours de danse, je me débrouillais pour faire un peu d’argent… À force de réseauter, je me retrouve programmateur de La Foire Africaine organisée par mr Yao. On m’envoie les titres de nombreux jeunes artistes et je tombe sur Ya Lévis et son groupe. Ils avaient quelque chose de spécial et je décide de les booker. Le Jour J, quelques couacs ont eu lieu et, alors que le reste de son groupe est envahi par le stress, Ya Lévis est le seul à rester calme. Je l’observe et je vois l’aura qu’il impose auprès des siens, sans parler de son talent naturel. J’ai compris que ce petit était un diamant rare. C’est un don qui m’est propre, j’arrive à déceler si un artiste va faire une carrière ou non. Au départ, je décide de l’approcher pour un featuring, étant donné que je m’autoproduisais. On fait le morceau, puis on descend dans le sud pour cliper. En studio, je m’aperçois qu’il est impressionné car il devait être habitué à des conditions beaucoup plus précaires. Même lors du clip, je me rends compte qu’il n’est jamais réellement sorti de son quartier. Il était encore mineur et tout allait très vite pour lui.
À notre retour sur Paris, Lévis me fait écouter un morceau de rumba congolaise qu’il est en train de peaufiner. Ce morceau me reste en tête pour une raison inexplicable. Un mois plus tard, lors d’un voyage aux Antilles pour rencontrer ma belle-famille, je me retrouve plongé dans leur mood : Admiral-T, Capleton, zouk, dancehall, etc. Je découvre une culture qui m’était inconnue. Un jour, j’entends un morceau lusophone qui me fascine : il s’agissait de la kizomba. Et là, j’ai un flash ! Je rentre à Paris, je convoque mon beatmaker et je demande à Ya Lévis de m’envoyer la version a cappella (juste la voix) du morceau de rumba qu’il m’avait fait écouter. Ya m’envoie son a cappella, c’était juste un couplet et refrain, enregistré à “l’arrache”, avec des voix non mixées (rires). Je demande à mon beatmaker de me faire la même rythmique que celle de la kizomba, mais en y ajoutant un pied urbain et une basse qui fait trembler les enceintes. Je voulais que ça cogne ! On y ajoute la voix a cappella de Ya Lévis et la rythmique initiale de la guitare sur la version rumba, mais en version synthétiseur. Et ce mélange improvisé a donné un banger ! Ya Lévis n’était pas convaincu et préférait la version faite avec ses frères. C’est à ce moment-là que s’est révélée mon autorité naturelle et ma vocation de futur producteur et manager. Je m’en souviens comme si c’était hier. J’ai rassemblé toute sa famille et je leur ai demandé de me faire confiance, que je prendrais tout en charge. Je leur ai posé un ultimatum en leur disant que si on ne sortait pas ce morceau avec ma vision, je ne travaillerais plus jamais avec eux. Ils ont pris le temps de réfléchir et ont accepté. Dans la foulée, je fais écouter le son à plusieurs personnes du métier qui pètent les plombs !
À l’époque, j’avais 5 groupes Facebook plein, avec 5000 amis chacun. Chaque matin, j’envoyais un message à tout mon répertoire avec le morceau qui était disponible sur SoundCloud. C’était un travail de malade. Personne n’a jamais su ma stratégie. Et, à force d’insister, le morceau a commencé à prendre, être partagé et tourné dans différents groupes. Le morceau tombe alors dans les oreilles de Noah Lunsi (très gros influenceur), qui fait une vidéo dans la foulée pour expliquer qu’il vient de tomber sur une « dinguerie » ! Il poste le morceau et là… On se réveille un matin et SoundCloud a explosé avec plus d’1 million d’écoutes sur le morceau ! Là, je comprends qu’il est temps de faire le clip. Et la suite vous la connaissez, Ya Lévis s’est imposé comme l’un des plus gros talents franco-congolais. Et j’ai choisi de devenir l’homme de l’ombre, celui qui façonne et propulse les talents. À ce moment, je ne m’en rends pas compte, mais je viens de créer une tendance. Sans aucune arrogance, je peux affirmer que je suis celui qui a créé l’afro love. Je n’ai juste pas mis un nom ou une empreinte sur ce que je venais de créer mais les faits sont là. On l’a fait avant Aya, avant Dadju, avant TayC.

Même si vous avez le flair du business, vous étiez un autodidacte dans le métier. Comment fait-on pour éviter les pièges, savoir négocier des contrats avec des maisons de disques, des festivals, etc ?
Je ne vais pas vous mentir, j’ai tout fait au culot et je me suis formé sur le tas. Je n’ai jamais de honte à dire quand je ne sais pas, donc j’observe, j’interroge les spécialistes et j’apprends très très vite. C’est cette humilité et cette curiosité permanente qui m’ont permis de comprendre rapidement tous les rouages du business de la musique. Mais à mes débuts, comme tout le monde, je me suis fait « douillé ». J’ai sous-évalué les prestations de mes artistes lors des premiers shows, j’ai eu à signer des contrats peu avantageux lorsque nous étions chez Capitol…
Je ne citerais pas de noms, mais les concernés se reconnaîtront. Disons que cela fait partie du « game » et de l’apprentissage.
Jusqu’au moment où tu maitrises toutes les clés. Ok, tu veux mon artiste pour tel festival ou tel concert ? Pas de problème mais, avant de t’annoncer un prix, je vais d’aborder chercher à comprendre combien va te rapporter ton event. Quelle est la capacité de la salle, combien de places payantes et à quel prix, qui récupère l’argent des entrées ou des boissons, es-tu accompagné par des sponsors, etc ? Tous ces calculs s’enchainent dans ma tête sans que mon interlocuteur ne s’en rende compte. L’essentiel est que chacun reparte avec de l’argent dans ses poches et sans avoir le sentiment de s’être fait flouer.
Désormais, mon objectif est l’Afrique. Je veux m’investir dans l’entertainment au sein de nos pays, où les besoins et attentes sont énormes !
Si vous deviez vous décrire en 3 mots ?
Passionné, bosseur et visionnaire.
Aviez-vous des exemples de réussite auxquels vous référer ?
Mon modèle dans le métier, celui qui me faisait devenir fou, c’était P.Diddy ! Je parle, bien sûr, en matière de business (rires). Je citerais également 50 Cent. Sa transition de rappeur à businessman a été incroyable. La seule chose qui me dérangeait avec 50 Cent, c’était ses trop nombreux clashs.
Puis, en me renseignant sur l’envers du décor du hip-hop américain, j’ai découvert une figure inconnue du grand public et dont le nom m’échappe. Toujours est-il qu’il est l’homme de l’ombre « au dessus » de tous. C’est celui qui négocie quasi tous les gros deals des artistes Noirs-Américains, qu’il s’agisse de Jay-Z ou Diddy, pour les aider à valoriser au mieux leurs labels, collaborations ou contrats de distribution avec Sony, Universal et autres.
Si vous aviez un conseil à donner à quelqu’un qui veut se lancer dans le business de la musique ?
Il faut tout simplement se poser les bonnes questions et ne pas se mentir à soi-même. Premièrement, as-tu la passion de la musique ? Ensuite, as-tu un véritable savoir-faire ou une expertise que tu as éprouvée ? As-tu analysé autour de toi tous les risques parce qu’il y a des risques ? Sais-tu comment récupérer des subventions, comment gérer avec la Sacem, etc ? Quand tu investis dans la musique, il faut être prêt à tout perdre car c’est ce qui arrive à 95% de ceux qui se lancent. Mon conseil est donc d’être parfaitement lucide sur tes compétences, sur ta surface financière et sur ta capacité de rebond.
Quels sont vos objectifs futurs ?
Aujourd’hui, Dieu merci, je suis déjà bien structuré en Europe. Désormais, mon objectif est l’Afrique. Je veux m’investir dans l’entertainment au sein de nos pays, où les besoins et attentes sont énormes ! Je veux m’investir pour les miens et ce ne sont pas des paroles en l’air. J’aurais pu aller en Côte d’Ivoire ou au Nigéria, mais j’ai décidé de commencer par chez moi, là où j’ai grandi, à savoir le Cameroun.
Contrairement aux artistes congolais, on a souvent l’impression que les artistes camerounais manquent de rayonnement, en dehors de leurs frontières. S’agira-t-il de votre combat prioritaire ?
Attention à ne pas tomber dans le piège. Qui sont les artistes congolais qui s’exportent mondialement ? Ce sont ceux qui viennent d’Europe. De Damso à Gims, de Tiakola à Niska. Alors, évidemment, il y a Fally Ipupa. C’est le numéro un, sans contestation possible. Mais hormis Fally Ipupa, quels sont les artistes congolais, vivant au Congo, qui s’exportent réellement ? Et pourquoi Fally est-il le boss ? Parce qu’il est le « fils » de Koffi, le boss de la génération précédente. Fally a mangé la danse, il a mangé la scène, il a mangé des cailloux. Il a évolué auprès des anciens, des plus grands et a été un bosseur acharné. Il a eu un cheminement qui fait qu’aujourd’hui il est là où il devait être. C’est quelqu’un qui a souffert pour sa passion. Même chose pour Innoss’B qui charbonne dans l’univers de la musique depuis l’âge de 12 ans. C’est gens-là ont construit des fondations solides, mais ils ne sont pas nombreux. Pour en revenir au Cameroun, le talent est présent mais il n’y a pas de réelles structures d’accompagnement. Il manque des managers, des producteurs, des experts en marketing, des vrais connaisseurs, pas ceux qui s’improvisent une vie de producteur du jour au lendemain. Vous rendez-vous compte que, au Cameroun, il n’y a aucun studio d’enregistrement aux standards internationaux ? Tu es obligé d’aller chez quelqu’un pour enregistrer ton titre. Et qu’en est-il des salles de concert ? C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé de miser sur mon pays car il y a tant de choses à faire !
Vous êtes un enfant du Cameroun, que l’on surnomme le “Continent”. Cela représente quoi ?
Le Cameroun, c’est la base, c’est ma force. Je me suis retrouvé dans des endroits avec des multimillionnaires, voire milliardaires, alors faire des allers-retours fréquents au pays me permet de garder les pieds sur terre. Quand je suis au Cameroun, je suis avec mes gars au quartier, je mange mes beignets-haricots au bord de la route. Et, en me voyant, tu ne pourras jamais imaginer ce que je fais dans la vie et l’ampleur de mon business.
Si je vous dis le mot « Roots », cela évoque quoi ?
Je pense à un arbre, aux fondations. Il est primordial de chérir ses racines, de garder sa famille proche de soi, c’est ce qui m’importe le plus.
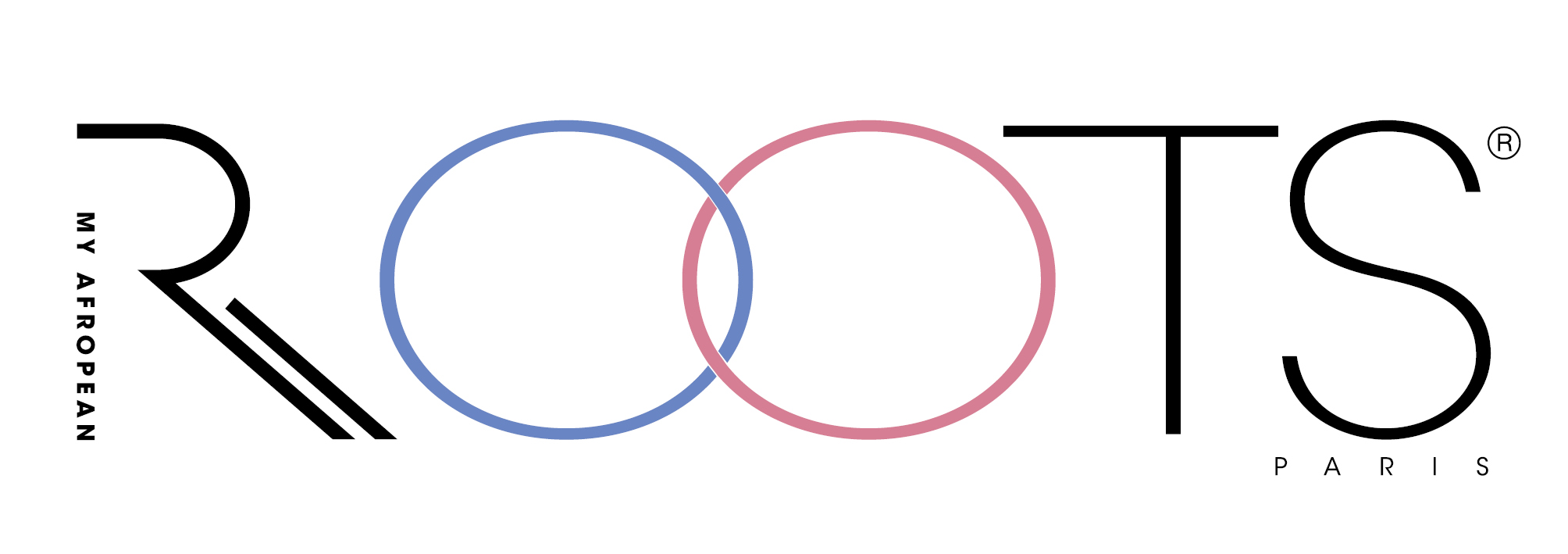
























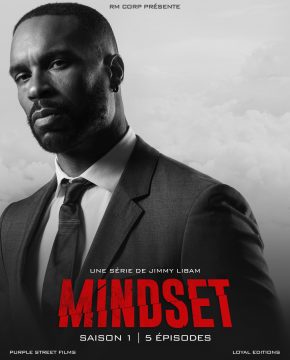






Commentaires