Contrôle d’identité, s’il vous plaît ?
Hammadoun Sidibe, j’ai 43 ans et je suis un entrepreneur français d’origine guinéenne et malienne. Je suis l’organisateur d’un événement qui s’appelle le Quai 54, je suis producteur de l’artiste Sadek et de ma sœur Amy et je suis également propriétaire d’un 235th BarberStreet à Paris.
Revenons sur la saga Quai 54. Comment avez-vous réussi à en faire l’évent de street basketball numéro 1 au monde ?
À la base, c’est un heureux concours de circonstances dû à l’évolution de ma passion. J’ai créé cet événement en 2003, à une époque où je jouais énormément au basket. À ce moment là, en 2000/2001, lorsque Michael Jordan a arrêté sa carrière, toutes les marques (Nike, Adidas…) ont freiné le marketing autour du basketball car c’était la fin d’une ère. Je me suis dit qu’au lieu d’attendre que les marques organisent des événements ou tournois pour le grand public, autant les créer nous-mêmes.
Quel a été l’élément déclencheur pour que le Quai 54 décolle immédiatement ?
C’etait pendant l’été 2003 qui correspondait à cette incroyable canicule à Paris. Nous avions à notre disposition la Halle Carpentier dans le 13ème arrondissement, un endroit où tous les professionnels et amateurs se réunissaient pour jouer. C’était un peu La Mecque du basket à Paris. Un jour, je leur ai dit : « au lieu de se voir ici tous les soirs, organisons un vrai tournoi où chacun ramènerait ses gars ». Le soir-même, tout le monde a monté sa team, nous avons constitué 16 équipes et le tournoi s’est déroulé le week-end suivant. À l’époque, il n’y avait pas les réseaux sociaux et on s’est pourtant retrouvé avec 160 joueurs et plus de 1000 personnes en tribunes. Comme beaucoup le savent, je suis « affilié » à la Mafia K’1 Fry (collectifs de rappeurs du 94 avec notamment Kery James, 113, Rohff, Dry…). J’ai demandé à mon frère Mokobé de venir, Pit Bacardi, Oxmo Puccino… tous les rappeurs de l’époque que je connaissais… et cela a créé l’engouement. Ma mère a fait des grillades, tout le monde mangeait et le Quai 54 a commencé sur les chapeaux de roue !
Vous avez tout de suite compris que ce serait un tournant de votre vie et que vous alliez en faire votre activité principale ?
Non du tout, je me suis seulement dit que c’est un évent que je comptais réitérer chaque année. L’année suivante, le directeur marketing de Nike que je connaissais car j’étais consultant pour eux sur la section basketball, m’a dit vouloir arrêter les événements basket et qu’ils préféraient me confier le budget pour que je fasse évoluer mon tournoi. Petit à petit, j’ai développé le Quai 54. Lors de la 3ème année, j’étais en contact avec l’équipe new-yorkaise de Fat Joe : Terror Squad et, avec mon associé Thibault de Longeville, nous avons décidé de les inviter à Paris pour assister au Quai. L’équipe de Fat Joe était la plus grosse équipe de street ball au monde, elle était gagnante du tournoi Rucker Park qui était la référence à New-York. Et figurez-vous qu’ils ont perdu lors du Quai 54 ! Cela a mis un sacré coup de projecteur sur l’événement et notre réputation a commencé à croître. Les amoureux du basket voulaient de plus en plus participer à l’événement, les professionnels étaient de plus en plus investis et il y avait moins d’amateurs. Un jour, j’ai eu l’occasion d’avoir Ludacris qui était à Paris pendant la fashion week. C’est l’année où j’ai signé avec Jordan. Cette même année correspondait à la disparition de Michael Jackson. Usher était également à Paris pour la fashion week. Une copine nous l’a ramené, il a pris le micro et a offert une prestation gratuite ! Nous avons commencé à avoir les meilleures équipes du monde, les meilleurs dunkers, Ludacris et Usher en show, sans oublier le soutien de mes frères Kery James, Mokobé et autres de la mafia K1 Fry… ça devenait de plus en plus gros, et on a bossé de façon acharnée chaque année, jusqu’à être ce que c’est aujourd’hui, en 2018 : le plus grand tournoi de street basketball au monde !
Comment Hammadoun, enfant du 9.4, a réussi à faire un événement d’une ampleur que même les Américains n’ont pas réussi à reproduire chez eux ?
C’est grâce à l’authenticité. Sans manquer de respect à qui que ce soit, je suis un gros travailleur, je n’ai jamais fait semblant. J’ai toujours essayé de garder ma vision et ne pas me reposer sur des acquis. Une chose a été déterminante : mon entourage. J’ai les bonnes personnes avec moi. Il ne faut pas prendre ses alter ego, mais des personnes qui vous complètent. Par exemple, Thibault, mon associé, est un as en ce qui concerne le marketing. J’apporte mes idées et lui va travailler cela à fond, de façon corporate. Je pense également à Mokobé qui, au-delà d’être un artiste, est un animateur exceptionnel qui sait avoir cette proximité avec le public. D’ailleurs, notre réussite est d’avoir su « starifier » davantage le public que nous-mêmes. Les gens veulent sentir qu’ils font partir de la fête.
Par la suite, vous avez déployé vos activités dans d’autres univers, notamment la production musicale...
Mon truc c’était le sport, le basket. Mais c’est vrai que j’ai beaucoup traîné dans les studios de musique. J’étais là pendant tous les enregistrements des albums de mes gars. Et je suis comme une éponge, je ne vais jamais quelque part sans apprendre. Je regardais les ingénieurs du son, j’essayais de saisir comment un morceau se structure… Pendant le Quai 54, on organise souvent des freestyles avec des personnes choisies dans le public. Il y avait un jeune qui venait régulièrement : Sadek. D’ailleurs, à l’époque, on l’appelait Little Fat Joe. C’était un rappeur de rue qui était un « tueur » en impro, il arrivait à soulever la foule ! À la fin du Quai, il me demande de m’occuper de sa carrière. Je n’étais pas du tout réceptif étant donné que ce n’était pas mon métier. Je lui ai donc conseillé de demander aux autres artistes qui étaient présents. Il a insisté pour que ce soit absolument moi. Je me suis dit que si ce « petit » regarde tous ces mecs-là : Oxmo, Booba, etc, mais ce n’est pas eux qu’ils sollicitent, c’est qu’il n’y a pas de hasard. Je suis un homme de challenges, j’y ai longuement réfléchi, mais j’ai encore décliné sa demande. La musique demande du temps et je n’aime pas faire les choses à moitié. Un jour, je suis avec ma mère, Sadek m’appelle. Je lui réitère mon refus en lui disant : « ça ne va pas être possible ». Il se met alors à me remercier en me disant : « je vais tout faire pour te rendre fier, merci beaucoup, etc ». En fait, il avait cru entendre « ça va être possible ». J’avais mis le haut-parleur et, alors que je m’apprêtais à le rectifier, ma mère m’a fait signe de me taire et m’a dit que c’était le bon Dieu qui l’envoyait. On a donc travaillé, pendant 3 ans dans la cave, et les majors nous ont contactés. Un jour, on balance un freestyle qui explose sur Boosk-P. Warner nous rencontre et nous fait signer notre premier contrat d’artiste. On fait un premier album qui ne marche pas du tout, la maison de disques nous rend alors le contrat. Imaginez notre déception ! Étant donné que je n’aime pas les échecs, j’ai monté mon label et on a continué à travailler en indépendant avec Sadek. Le travail acharné a fini par payer et Sadek a fini avec disque d’or, disque de platine, etc. Les portes ont commencé à s’ouvrir, c’est l’effet boule de neige. C’est ainsi qu’il s’est retrouvé au cinéma, dans un film où il partage l’affiche avec Gérard Depardieu. Avec la volonté de Dieu, le travail finit toujours par payer.
Enfin, l’ouverture d’un 235th BarberStreet…
Depuis très longtemps, j’ai toujours voulu faire un barbershop à Paris, mais j’étais sur d’autres projets. Entre temps, j’ai une copine qui m’appelle pour me dire : « il y a un barbershop qui a ouvert dans le 19ème, dans l’esprit de ce que tu voulais faire ». Le fondateur, Sambou Sissoko, me connaissait car il venait de temps en temps au Quai 54. On a eu un très bon feeling, et j’aime donner la force aux frangins qui bossent sérieusement. Je lui ai proposé un corner au Quai 54 et il a carrément installé un barber pendant l’évènement ! C’était en 2015, sur la place de la Concorde. Je reste un homme d’affaires, mais plutôt que d’aller créer un concept concurrent, autant accompagner un projet déjà existant, créé par un bosseur, un bon garçon qui a la dalle de réussir et qui, en plus, est de la même origine que moi. C’est ainsi que j’ai décidé de lancer la franchise 235th BarberStreet à Paris République.
Des projets de développement en Afrique ?
Orange m’a proposé de faire le Quai 54 en Côte d’Ivoire pour une édition Afrique. Pour un projet comme le mien, je ne vois que la Côte d’Ivoire ou l’Angola susceptibles de pouvoir nous accueillir. Ils sont très fans de basket-ball, de musique, et ce sont les plus avancés en terme d’infrastructures, tout simplement. Pour le Mali, le plus important pour moi était d’y construire ma maison et mettre bien la famille…
Si vous aviez un conseil à donner à des entrepreneurs ?
Si tu n’as rien fait, ce n’est pas que je ne vais pas te respecter, mais je ne vais pas t’écouter. Ne prenez conseil qu’auprès des gens qui ont déjà fait quelque chose de palpable. Mais la plus importante des choses est d’être honnête avec soi-même. Il y a une phrase que je déteste : « si lui l’a fait, alors je peux le faire ». C’est faux. Tu ne connais pas les compétences de la personne, ses sacrifices, ses réseaux, sa détermination, sa vision. Mon conseil serait donc de s’asseoir et se regarder le plus objectivement possible. L’entrepreneuriat n’est pas fait pour tout le monde, mais si tu arrives à la conclusion que tu es fait pour cela, alors vas-y à fond et ne compte pas tes heures de travail !
Si je vous dis Roots, cela vous évoque quoi ?
C’est déjà encré en moi. Je suis un blédard de base, même si j’ai grandi en France (rires). Dans la façon de faire, manger avec les mains, je demande la télécommande comme un daron, je vais chez la famille tout le temps pour dire bonjour, etc. J’adore le mot Roots, mais il est bon pour les Américains. Pour quelqu’un qui connaît ses racines, comme nous les Africains, c’est quelque chose de déjà encré en nous.
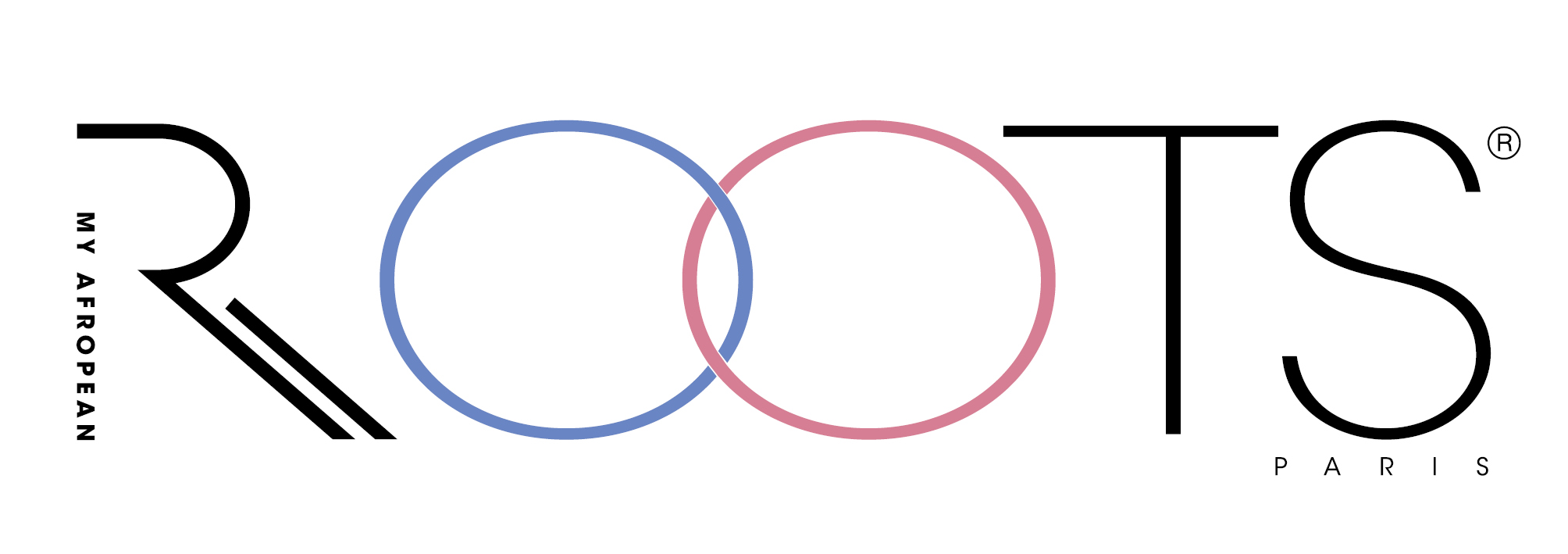
































Commentaires